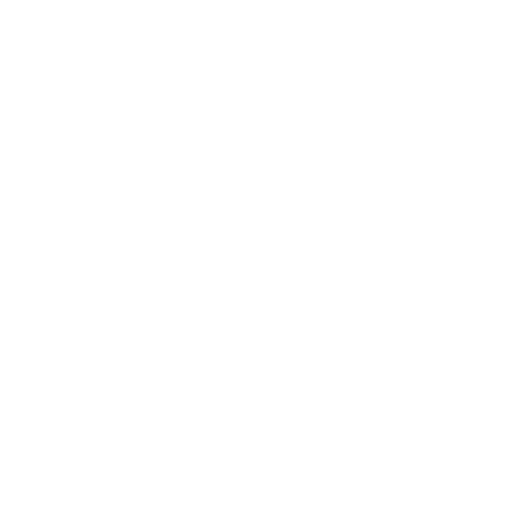La Maljoyeuse, 1962, avec les petites fenêtres en façade. À gauche, on peut encore apercevoir l’ancien hangar en bois.
Mémoire d’un lieu singulier
et souvenirs en pagaille
Nostalgie, quand tu nous tiens…
La Maljoyeuse, disparue, c’est cette petite maison qui n’en finit pas de nous manquer. On y a passé beaucoup d’instants précieux, nous l’avons vue évoluer avec le temps, elle nous rappelle évidemment plein de souvenirs. Et elle nous a vus grandir aussi, elle fait un peu partie de notre ADN.
“Quand on aime la vie, on aime le passé, parce que c’est le présent tel qu’il a survécu dans la mémoire humaine.”
Marguerite Yourcenar,
Les yeux ouverts
La Maljoyeuse en 1967.
Hiver ’68.
L’âtre, indispensable ami.
La vie quotidienne à La Maljoyeuse avec son manque de confort nous a apporté quelque chose de rare : l’authenticité du rudimentaire, une sorte de retour aux sources que chacun aura vécue avec plus ou moins de bonheur. Profiter d’une belle soirée au coin du feu, en hiver, c’était bien. Anticiper et trouver le bois, le couper, le stocker, le laisser sécher, c’était du boulot, mais c’était bien. Mettre un peu d’eau dans une casserole émaillée des années ’50 dont personne ne voulait plus pour faire cuire quelques spaghettis qui finiraient malgré tout tièdes dans l’assiette, ce n’était pas rien : pas d’eau courante, ici, mais c’était bien. Les lérots, souris et autres rongeurs acrobates qui couraient partout avaient la fâcheuse tendance à s’occuper de nos pâtes bien avant nous, mais ça aussi, c’était bien.
Se satisfaire de ce qu’il y avait
Des meubles glanés ici et là, loin d’être assortis, un ou deux fauteuils, un ou deux canapés en velours olive étaient loin d’être confortables. Mais il n’y avait pas de plus grand réconfort que d’y passer une soirée, tantôt seul, tantôt avec des potes, à méditer devant la cheminée ou à refaire le monde. Les plaisirs étaient simples et un jeu de cartes pouvait occuper pendant tout le séjour. Évidemment qu’on n’a jamais retrouvé l’as de pique, mais il avait été remplacé depuis longtemps par le roi de cœur d’un autre jeu, barré avec un stylo humide laissé là, par le précédent, dans le tiroir de la cuisine. Les cartes portaient le poids du temps et trahissaient toutes les parties précédentes, jouées à mains sales, mais on jouait.
Les deux cruches en plastique turquoise, pour aller puiser l’eau du puits. La bassine jaune pour faire la vaisselle, les lits superposés trop petits aux sommiers défoncés, la « chambre bleue » et ses lits en fer forgé, plus défoncés encore. Une toilette pour le moins rudimentaire. Les hamacs suspendus entre les sapins majestueux. La route. Des fois, la peur, la nuit, quand les chouettes causent aux sangliers dans les bois. Les cannes à pêche en bambou, leurs flotteurs et les petits plombs qu’il fallait ajuster à la profondeur momentanée de la rivière. L’odeur de feu, partout. Le grenier et ses innombrables nids de guêpes. La lune, les étoiles et les orages comme nulle part ailleurs.
Il y avait aussi le vieux fouet en fer blanc qui avait connu 14-18. C’était génial comme il nous faisait une incroyable pâte à crêpes dans ce saladier désuet qu’on avait toujours connu, émaillé avec les grosses fleurs sur fond beige un peu craquelé. La poêle en fer, bien lourde, faisait vraiment beaucoup de bruit sur la cuisinière au gaz des sixties. Et sa poignée nous brûlait les mains : retourner les crêpes à mi-cuisson, il faut bien le dire, c’était assez sportif. Mais au final, ça donnait le meilleur souper du monde, à la lueur des chandelles.
Toujours quelque chose à faire
S’occuper du bois, de l’eau, de l’éclairage, c’était le minimum vital. Il y avait toujours quelque chose à améliorer ou à réparer. Ça faisait partie des plaisirs de l’endroit. Dehors ou dedans, il y avait toujours à faire, avec les outils disponibles, c’est-à-dire pas grand-chose : un gros marteau, une hache, un tournevis un peu trop grand et une poignée de clous tordus et rouillés qu’il fallait redresser au préalable. Rien de sophistiqué, mais la débrouille à chaque étape. Et ça marchait.
Bref, le minimal était maximal.
La Maljoyeuse
Depuis 1915
« La Maljoyeuse » a été construite entre 1914 et 1915 le long de la route Bertrix-Herbeumont afin d’y loger le chef de gare de Cugnon-Mortehan. Mais la guerre éclate, les Allemands s’emparent rapidement de la ligne ferroviaire 163A : l’armée allemande y installera plutôt l’officier chargé du contrôle des activités économiques de la région : ardoisières, chemin de fer et exploitation forestière. À la fin de la Première Guerre mondiale, elle devient propriété de l’État belge et servira finalement de logement pour le chef de gare de Cugnon-Mortehan durant l’entre-deux-guerres. En 1941 , elle devient une propriété privée. En 1961, elle est acquise par M. Leclercq-Bocken et restera dans la famille jusqu’à nos jours.
Bâtie sur un promontoire en pleine forêt qui domine le site des anciennes ardoisières de Wilbauroche, son accès était aisé, tant par la route que par le chemin de fer qui desservait la petite gare de Cugnon-Mortehan, située à quelques centaines de mètres. La maison était assortie de dépendances dont un grand hangar en bois qui subsistera jusque dans les années 1970.
Le nom
On baptisera la maison du nom d’une carrière à ciel ouvert située dans un lieu-dit tout proche : La Maljoyeuse. Ce nom a probablement été donné par les scaltions (ouvriers ardoisiers, en wallon), qui y voyaient s’arrêter la malle-poste Bertrix-Herbeumont quotidiennement en fin d’après-midi.
C’était le signal de la fin imminente de la journée de travail. Ils pourraient alors se rendre dans un des multiples troquets qui jonchaient la vallée à l’époque de l’extraction ardoisière.
Cet arrêt de la malle-poste (sorte de diligence de l’époque, tirée par deux chevaux) aurait donné son nom à la carrière toute proche : « la malle joyeuse », puis, par contraction, la Maljoyeuse.